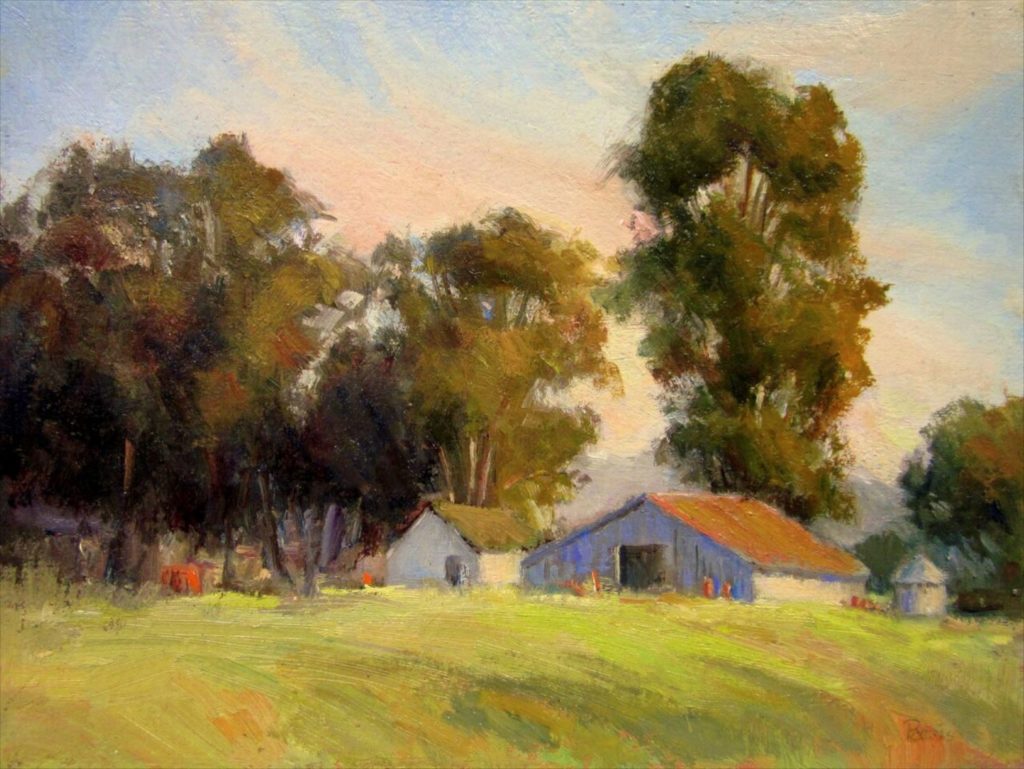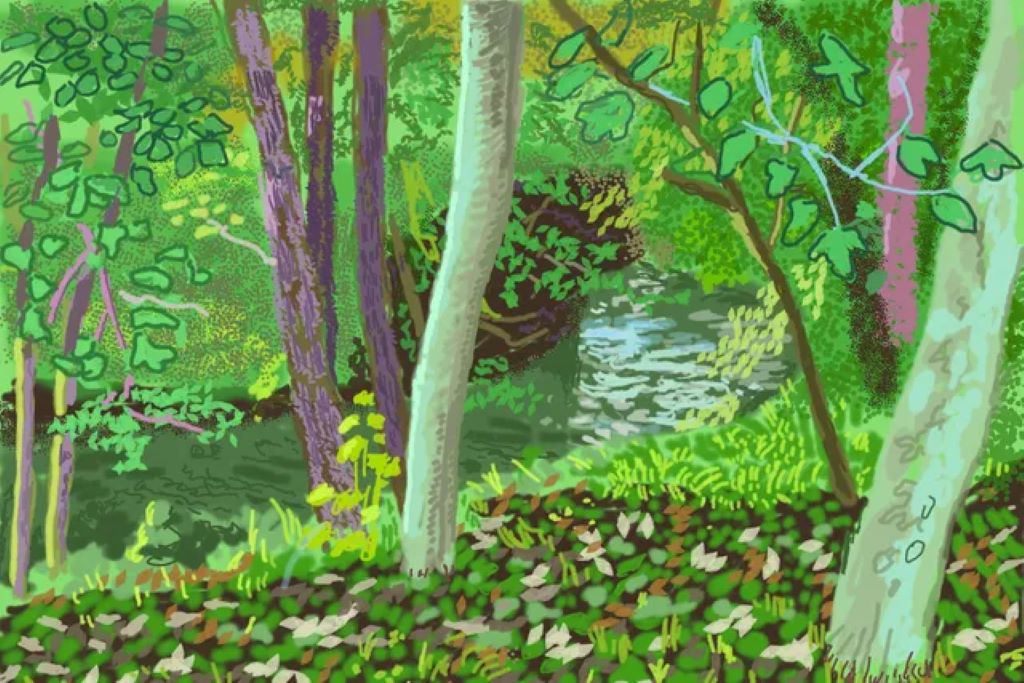Le wwoofing est une porte ouverte sur d’autres manières de vivre : plus sobres, plus humaines, plus engagées. Une manière de remettre en question le modèle dominant, de se former concrètement à l’autosuffisance, et d’expérimenter, à échelle réduite, une vie en rupture avec le capitalisme. Adrian, ancien étudiant en ingénierie à l’EPFL, nous partage son expérience. Il raconte comment, à travers le woofing, il a trouvé des réponses à ses doutes, nourri ses convictions, et entamé une réorientation professionnelle.
J : Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c’est quoi exactement le woofing ?
A : Le woofing, c’est une organisation internationale. Chaque pays a sa propre plateforme en ligne. Tu t’y inscris pour une vingtaine de francs, et tu accèdes à des annonces postées par des particuliers qui proposent un échange : tu viens travailler chez eux, et en contrepartie tu es nourri, logé, parfois un peu défrayé.
Selon les règles de l’association, tu ne travailles pas plus de 4 heures par jour, pour éviter toute forme d’exploitation. Je trouve que c’est un excellent deal : tu aides un peu, tu apprends beaucoup, et tu découvres des modes de vie différents.
La plupart du temps, ce sont des gens qui ont des projets agricoles, des petits jardins, des animaux… C’est l’occasion de mettre les mains dans la terre, de vivre au rythme de la nature. Ce que j’ai adoré, c’est découvrir un quotidien alternatif, loin de la norme. Beaucoup vivent dans des tiny houses, parfois en quasi-autonomie. Tu te rends compte que c’est possible de vivre avec peu : sans eau courante, sans électricité conventionnelle, juste quelques panneaux solaires sur le toit.
Chez nos hôtes, l’objectif était de vivre sans pétrole. C’est évidemment très difficile, mais ils faisaient tout pour limiter leur impact. Par exemple, dans leur jardin, ils n’utilisaient que des outils manuels : fourche, faux, hache, pelle… Rien de motorisé. Bien sûr, ce mode de vie est plus réaliste sur de petites surfaces. Mais ça reste très inspirant.
J : Tu peux nous partager quelques anecdotes de ton expérience ? Les hauts, les bas ?
A : Franchement, il y a eu très peu de « bas ». Les conditions étaient simples, c’est sûr, mais ça ne m’a jamais vraiment dérangé. On dormait dans une petite caravane sur leur terrain, il y avait aussi une cabane en bois. Les toilettes sèches étaient au fond du jardin… et oui, il faisait un peu froid le matin, mais c’était presque poétique : tu sors, tu respires l’air frais, tu entends les oiseaux, il y a de la rosée partout. Même les toilettes ne sentaient pas plus mauvais que des toilettes classiques, pour être honnête.
Pour les douches, on allait de temps en temps chez les parents de nos hôtes, qui habitaient dans le village voisin. Sur place, on faisait un peu toilette de chat. Ça peut sembler inconfortable vu de l’extérieur, mais on s’y fait très vite.
Ce que je retiens surtout, c’est la richesse humaine de cette expérience : les échanges, l’authenticité, la bienveillance. On a partagé tellement de moments forts, de discussions profondes : on passait des soirées entières à parler dans leur salon, de politique, de physique quantique, de féminisme, de théorie de l’effondrement, de colonialisme… Ils étaient passionnés, cultivés, très engagés. C’était stimulant, parfois même bouleversant.
Et puis, tu t’en fiches assez rapidement de ne pas être parfaitement propre. Tu travailles la terre, tu transpires, et c’est OK. Ils faisaient leurs produits d’hygiène eux-mêmes, on se rinçait facilement, sans en faire trop. C’était simple, mais ça suffisait.
J : Comment s’adapte-t-on à une nouvelle routine aussi différente de notre quotidien ?
A : Vivre en woofing, c’est super détendu. Les hôtes t’expliquent comment ils fonctionnent chez eux, ce qu’ils attendent de toi, et si quelque chose ne te convient pas, tu peux en discuter sans problème. Si vraiment ça ne colle pas, tu es libre de partir.
Au fond, la vraie question, c’est : comment change-t-on ses habitudes ? Pour moi, viser l’autonomie ou transformer profondément nos modes de vie, c’est un processus qui prend du temps, peut-être même plusieurs générations. Aujourd’hui, être complètement autonome est extrêmement difficile. On est conditionné à consommer, à dépendre de systèmes extérieurs.
Mais on peut avancer, doucement. Petit pas par petit pas. Avec le temps, ces petits gestes s’accumulent et créent quelque chose de plus cohérent.
De mon côté, j’ai commencé par réduire ma consommation de viande, puis à ne plus en cuisiner, et je suis devenu végétarien. Ensuite, je me suis tourné vers la seconde main, j’ai arrêté d’acheter du neuf. La prochaine étape, c’est une cuisine zéro déchet : bocaux en vrac, fabrication d’éponges maison, emballages en tissu ciré pour remplacer le film plastique… Des gestes simples, mais qui comptent. J’ai aussi commencé un petit potager. Et après ma formation à la HEP, j’aimerais partir à vélo visiter des écolieux, faire du woofing, participer à des chantiers collaboratifs, apprendre à construire des cabanes. J’aimerais acquérir assez d’expérience pour, un jour, créer mon propre lieu de vie alternatif et accueillir d’autres personnes.
C’est tout un parcours fait de petites étapes, de transitions. Et ce n’est pas grave si on n’est pas encore totalement indépendant. On a encore besoin d’argent, d’aller au supermarché, de payer nos assurances. Mais peut-être qu’à force de transmettre des savoirs, on aura de moins en moins besoin du système tel qu’il est aujourd’hui. C’est un changement à long terme.
J : Est-ce que tu étais un peu rémunéré pour ton travail ?
A : Pas en argent, non. Mais en échange, tu gagnes en connaissances, en rencontres humaines, en apprentissage de soi et des autres. C’est une autre vision du travail, plus anticapitaliste, et ça me parle beaucoup [rires].
J : Et socialement, comment ça se passait ? Il y avait d’autres jeunes ?
A : Il y avait ma copine bien sûr, et la famille qui nous hébergeait, avec leur petit garçon de sept ans. On a eu beaucoup de chance : ils étaient très ouverts, à l’écoute, avec une belle sensibilité autour du consentement et de la communication. On a pu échanger en toute confiance, c’était très enrichissant.
Ils avaient aussi des outils de communication vraiment solides, qu’on voyait à l’œuvre dans leur couple. C’était inspirant. Et en même temps, on pouvait aussi avoir du temps pour nous. Je suis plutôt introverti, donc j’appréciais d’avoir des moments calmes, en solo.
J : Comment avez-vous choisi cette destination ?
A : C’est ma copine qui m’a lu leur profil sur le site. Ils vivaient dans une tiny house, sans pétrole, et leur mode de vie nous a tout de suite plu. On les a contacté… et ça a matché tout de suite.
J : Comme beaucoup, j’hésite encore à me lancer dans ce type de projet. Qu’est-ce qui rend le woofing « si bien » selon toi ?
A : Honnêtement, si tu as un peu de temps, tu n’as rien à perdre. L’inscription au site coûte une vingtaine de francs, c’est tout. Ensuite, tu contactes les hôtes, tu échanges avec eux à l’avance, et tu vois si le feeling passe. Et si ça ne colle pas au téléphone, tu peux toujours chercher un autre lieu.
Les gens qui proposent du woofing sont souvent super accueillants, habitués à recevoir. Et pour moi, ce qui est vraiment précieux, c’est de sortir de sa zone de confort. Quand on a grandi dans un seul modèle, capitaliste, productiviste… on ne réalise pas toujours qu’il en existe d’autres.
C’est le grand défi de notre génération : inventer des alternatives. Et pour ça, il faut oser aller voir ailleurs, expérimenter. Quand j’en parle avec mes parents, parfois on se heurte un peu, on n’a pas grandi dans le même monde. Mais justement, ces échanges sont riches. Ils ont leur expérience, j’ai mes questions, et ça fait avancer la discussion.
Le woofing, c’est une super porte d’entrée. Ça montre que faire autrement, c’est non seulement possible, mais que ça peut être joyeux, créatif, inspirant. Ça ouvre l’imaginaire. Bref: c’est un gros oui.